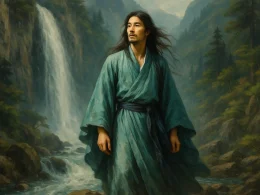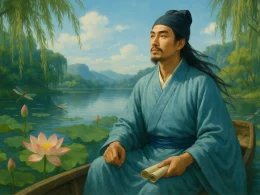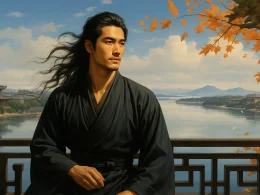Zhou Bangyan (周邦彦 1056 - 1121), originaire de Qiantang (actuelle Hangzhou, Zhejiang), fut le maître accompli du ci de style wanyue (élégant et retenu) sous la dynastie Song du Nord. Virtuose de la théorie musicale, ses ci se distinguent par leur raffinement flamboyant et leur perfection technique. Il créa des dizaines de nouveaux schémas mélodiques (cipai) et respecta des règles tonales strictes, ce qui lui valut le titre de « Couronne des poètes du ci ». Son influence s'étendit aux grandes figures du Song du Sud comme Jiang Kui et Wu Wenying, le consacrant comme patriarche fondateur de l'École du ci métrique.
Œuvres principales
Vie
Les ancêtres de Zhou Bangyan étaient originaires de Qiantang (actuelle Hangzhou, Zhejiang), mais migrèrent ensuite dans le district de Yin, Mingzhou (actuelle Ningbo, Zhejiang). Dès son jeune âge, il manifesta un talent littéraire exceptionnel et des aptitudes musicales. Les archives historiques rapportent qu'il était « largement versé dans les œuvres des Cent Écoles de pensée, avec un don particulier pour composer des mélodies ». En 1083, à vingt-sept ans, Zhou entra à l'Académie impériale de la capitale comme étudiant du Collège extérieur. Sa présentation de Rhapsodie sur la capitale de Bian (Biandu Fu), un long poème fu de plus de dix mille caractères exaltant la splendeur de Kaifeng et louant les Nouvelles Politiques, fit sensation dans les cercles littéraires. L'empereur Shenzong fut si impressionné qu'il le nomma Taixuezheng (Directeur de l'Académie impériale), marquant le début de sa carrière officielle.
Durant l'ère Yuanyou (1086–1094), lorsque les factions conservatrices étaient au pouvoir, Zhou fut marginalisé pour son soutien passé aux Nouvelles Politiques et relégué à des postes provinciaux comme professeur à Luzhou et magistrat de Lishui. Cette période d'exil influença profondément son écriture, inspirant de nombreuses œuvres célèbres exprimant la mélancolie du voyage, comme Cour emplie de parfums : Composé un jour d'été dans les monts Wuxiang à Lishui. En 1097, lorsque les réformistes reprirent de l'influence, Zhou fut rappelé dans la capitale comme Guozijian Zhubu (Secrétaire de la Direction de l'Éducation). Après l'avènement de l'empereur Huizong, sa carrière prospéra. Il occupa des postes tels que Mishusheng Zhengzi (Éditeur à la Bibliothèque du palais), Xiaoshulang (Correcteur de textes) et Kaogong Yuanwailang (Vice-directeur du Bureau des évaluations). En 1116, presque sexagénaire, Zhou fut nommé Dashengfu Tiju (Directeur du Bureau musical Dasheng), supervisant la composition et la révision de la musique de cour, l'apogée de sa carrière artistique.
Au Bureau musical Dasheng, Zhou déploya pleinement ses talents musicaux. Il systématisa les mélodies anciennes, créa de nouveaux airs et collabora avec Moqi Yong et Tian Wei pour perfectionner le système musical Dasheng. Beaucoup des mélodies originales conservées dans son Recueil Qingzhen, comme Prince de Lanling (Lanling Wang) et Offense des fleurs (Hua Fan), furent le fruit de cette période. En 1121, Zhou mourut dans la préfecture de Yingtian (actuelle Shangqiu, Henan) à soixante-cinq ans. À titre posthume, il reçut le titre de Xuanfeng Dafu et fut enterré dans les monts Nandang à Hangzhou. Durant l'ère Chunxi (1174–1189) du Song du Sud, son petit-fils Zhou Zhu compila et publia les Œuvres complètes du Maître Qingzhen en vingt-quatre volumes, assurant la préservation de l'héritage de ce maître poète-compositeur.
Style littéraire
Surnommé le « Du Fu du ci », le Recueil Qingzhen de Zhou Bangyan contient 186 ci utilisant 112 schémas mélodiques, atteignant de nouveaux sommets dans l'exploration thématique, l'innovation formelle et l'expression artistique. Ses œuvres se classent en quatre thèmes principaux : poèmes sur les objets (yongwu), paroles romantiques (yanqing), vers du voyage (jilü) et méditations historiques (huaigu), chacun comptant des chefs-d'œuvre impérissables.
- Poèmes sur les objets : Les ci yongwu de Zhou révèlent son observation aiguë et son artisanat exquis. Danse de l'outre à eau : Brûlant du santal (Sumuzhe: Liao Chenxiang) saisit l'essence des feuilles de lotus avec des vers vivants : « Le soleil du matin sèche la pluie de la nuit sur les feuilles ; / Sur une eau claire et ronde, chacune se dresse dans la brise. » Six laideurs : Après la chute des roses (Liuchou: Qiangwei Xie Hou Zuo) personnifie les pétales tombés : « De longues tiges accrochent délibérément les passants, / Comme tirant des manches pour murmurer des chagrins de séparation sans fin. » Ces œuvres adhèrent à la tradition de « décrire les objets sans en être confinés » tout en progressant vers un nouveau royaume d'« allégorie profonde ».
- Paroles romantiques : Les ci yanqing de Zhou dévoilent sa compréhension nuancée des émotions. Errance juvénile : Poignard brillant comme l'eau (Shaonian You: Bing Dao Ru Shui), relatant sa romance avec la courtisane Li Shishi, oppose des moments tendres (« face à face, jouant du sheng ») à des adieux douloureux (« les chevaux glissent sur le givre épais »). Chanson de galanterie : Vert nouveau dans le petit étang (Fengliuzi: Xin Lü Xiao Chitang) exprime des désirs tacites par des images voilées : « J'envie les hirondelles volant vers des chambres dorées, / Leurs vieux nids encore intacts. » Bien que ces œuvres effleurent le sensuel, elles restent « élégantes sans vulgarité, belles sans licence », élevant la tradition Huajian.
- Vers du voyage : Les ci jilü de Zhou condensent ses expériences comme fonctionnaire itinérant. Cour emplie de parfums : Composé un jour d'été dans les monts Wuxiang à Lishui (Man Tingfang: Xiari Lishui Wuxiangshan Zuo) évoque la Chanson du luth de Bai Juyi : « Longtemps je m'appuie sur les balustrades— / Près de bambous amers et de roseaux jaunes, / Je rêve d'un bateau pour Jiujiang. » Froid à la fenêtre grillagée : Les corbeaux crient dans les saules sombres (Suochuanghan: An Liu Ti Ya) oppose les joies passées à la désolation présente : « Tard dans la vie, où j'errais autrefois avec délice… » Ces œuvres transforment les voyages personnels en réflexions universelles sur l'existence, rayonnant d'un profond pouvoir artistique.
- Méditations historiques : Les ci huaigu de Zhou montrent sa conscience historique. Rivière de l'Ouest : Nostalgie de Jinling (Xihe: Jinling Huaigu) adapte Cité de pierre et Ruelle de la queue noire de Liu Yuxi en images poignantes : « Les arbres des falaises penchent encore périlleusement », encapsulant l'essor et la chute des Six Dynasties. Joie céleste : Vert fané sur le chemin de la terrasse (Qitianle: Lü Wu Diao Jin Taicheng Lu) utilise des scènes automnales de l'ancienne capitale des Dynasties du Sud pour exprimer des inquiétudes voilées sur les crises des Song du Nord. Ces œuvres rompent avec la nostalgie conventionnelle, forgeant un style qui « fond les vers anciens comme s'ils étaient siens ».
Innovations artistiques
Les contributions de Zhou Bangyan au ci résident dans trois dimensions — les schémas tonaux, la composition structurelle et l'art linguistique — toutes profondément influencées par son expertise musicale.
- Schémas tonaux : Zhou établit un système tonal rigoureux. Il standardisa plus de 50 cipai, dont plus de 10 créations originales comme Chant du dragon propice (Ruilongyin) et Lentes vagues lavant le sable (Langtaosha Man). Ses ci distinguent strictement les quatre tons (plat, montant, descendant, entrant), comme dans Prince de Lanling : Ombres droites des saules (Lanling Wang: Liu Yin Zhi) : « Je monte haut, regardant vers ma terre natale— / Qui reconnaît ce voyageur fatigué de la capitale ? » Ici, les variations tonales intensifient l'expressivité. Zhang Yan dans Origines du ci loua Zhou : *« Ses *ci* sont doux, harmonieux et élégants, habiles à mêler les vers poétiques, bien qu'écartés parfois des partitions musicales — preuve de son talent remarquable. »*
- Composition structurelle : Zhou développa une technique narrative-expansive unique. Chant du dragon propice : Chemin vers la terrasse Zhang (Ruilongyin: Zhangtai Lu) emploie une structure tripartite « présent-passé-présent », déployant les émotions par des changements temporels. Six laideurs : Après la chute des roses (Liuchou: Qiangwei Xie Hou Zuo) utilise la dégustation de vin comme fil, stratifiant les lamentations pour le printemps, la pitié pour les fleurs et le désir pour l'aimé. Cette méthode « esquisser et élever » préserve les sauts lyriques du ci tout en améliorant la cohérence logique.
- Art linguistique : Zhou forgea un langage exquisément raffiné. Il maîtrisa les références indirectes — utilisant « rayons d'osmanthe » pour la lumière lunaire, « vents de prunier » pour le début de l'été. Sa diction est précise : « Ombre de midi — arbres fins, clairs et ronds » (qingyuan) capture parfaitement la beauté arboricole. Il excella à adapter des vers classiques — Rivière de l'Ouest : Nostalgie de Jinling fusionne sans couture yuefu et poésie Tang en un tout nouveau. Ce langage « orné mais méticuleux » devint le modèle pour le ya ci (ci élégant) du Song du Sud.
Héritage
L'héritage artistique de Zhou Bangyan, continuellement interprété et développé depuis le Song du Sud jusqu'à la dynastie Qing, forma une lignée de huit cents ans connue comme l'École Qingzhen du ci.
- Song du Sud : Les poètes vénérèrent Zhou comme leur patriarche. Jiang Kui hérita de sa rigueur tonale, visible dans des airs originaux comme Fragrance secrète (Anxiang) et Ombres éparses (Shuying). Wu Wenying étendit ses techniques structurelles en un style « dense et splendide ». Shi Dazu et Zhou Mi se flattaient d'imiter les ci de Zhou. Zhang Yan dans Origines du ci établit « vide clair » (qingkong) et « solidité texturée » (zhishi) comme deux paradigmes du ci, avec Zhou incarnant le dernier.
- Dynastie Qing : Durant la renaissance du ci, l'Anthologie des quatre maîtres du ci des Song de Zhou Ji plaça Zhou aux côtés de Xin Qiji, Wang Yisun et Wu Wenying, préconisant : « Cherche le chemin à travers Bishan (Wang Yisun), passe par Mengchuang (Wu Wenying) et Jiaxuan (Xin Qiji), pour revenir à l'harmonie parfaite de Qingzhen. » Chen Tingzhuo dans Causeries sur le ci du Pavillon de la Pluie blanche nota que Zhou « conclut l'ère de Su Shi et Qin Guan, et initia celle de Jiang Kui et Shi Dazu. » Les maîtres tardifs comme Zheng Wenzhuo et Zhu Zumou étudièrent méticuleusement les ci de Zhou, éditant plus d'une douzaine d'éditions du Recueil Qingzhen.
- Érudition moderne : Zhou fut réévalué. Les Remarques sur la poésie des Song de Wang Guowei critiquèrent son « manque de génie créatif » mais reconnurent son « artisanat sans égal pour exprimer les émotions et décrire les objets. » Les Schémas tonaux du ci des Tang et des Song de Long Yusheng utilisent les ci de Zhou comme modèles métriques. Ye Jiaying identifia son « triomphe par arrangement intellectuel » comme un paradigme parallèle au « génie improvisateur » de Su Shi. Dans les années 1980, le sinologue américain Stephen Owen introduisit les ci de Zhou en Occident, suscitant un intérêt international.
- Musique : L'héritage musical de Zhou perdure. Bien que la musique Dasheng qu'il conserva se perdît après la chute des Song du Nord, dix-sept chansons notées dans les Chansons du Maître de la Pierre blanche (Baishi Daoren Gequ) de Jiang Kui préservent des aperçus de la musique ci des Song. Des compositeurs contemporains comme Lin Shengxi (Taïwan) et Qu Wenzhong (Hong Kong) ont mis en musique des ci de Zhou, ravivant ces chefs-d'œuvre millénaires sur les scènes modernes.
L'image historique de Zhou Bangyan évolua de « poète libertin » à « parangon du wanyue ». Ce maître artistique, avec son « langage fluide comme des perles roulantes », ses « structures pionnières-et-intégratrices » et sa « précision tonale en chaque mot et pensée », éleva la poésie ci à de nouveaux sommets. L'évaluation du Siku Quanshu reste définitive : *« La profonde compréhension de Bangyan du tempérament musical le couronna comme le plus grand des poètes du *ci. Ses schémas mélodiques exigent l'adhésion non seulement aux tons plats et obliques mais aussi aux distinctions entre tons montants, descendants et entrants. » Ceci est à la fois le verdict final sur l'art de Zhou et la plus fine interprétation de sa stature historique.