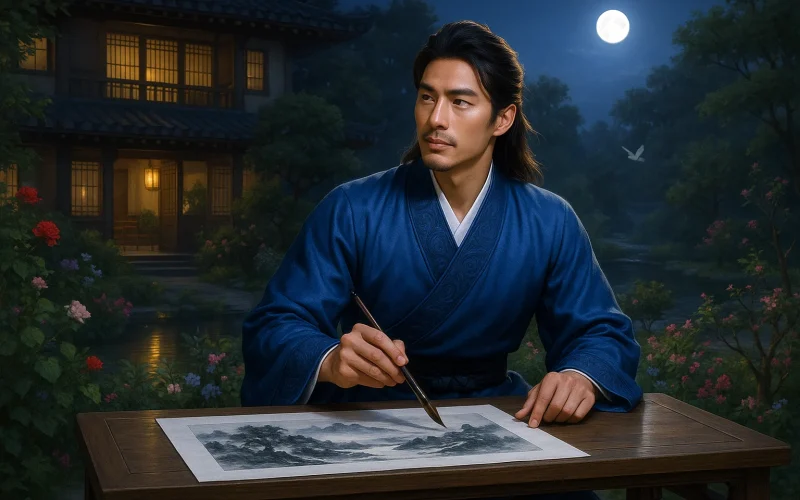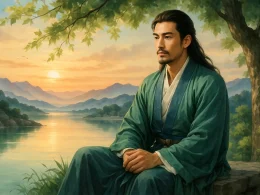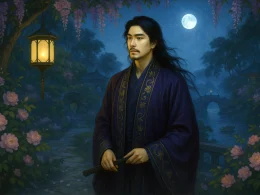Liu Fangping (刘方平 env. 742 – env. 785), originaire de Luoyang dans le Henan. Poète ermite et peintre à la charnière entre le Haut et le Moyen Tang, il se distingua par un style poétique délicat et subtil, habile à dépeindre les lamentations de gynécée et les nuits lunaires. Bien que seuls 26 de ses poèmes subsistent dans les Poèmes complets des Tang, des œuvres comme Nuit de lune et Plainte printanière lui assurèrent une place dans le canon de la poésie tang. Acclamé comme « la voix pure du Haut Tang et l’annonce du Moyen Tang », sa poésie fusionna la lucidité du style Qi-Liang avec la sérénité zen, influençant profondément la tradition lyrique ci postérieure et la littérature féminine de l’ère Heian au Japon.
Œuvres majeures
Vie
Liu Fangping descendait de l’aristocratie Xiongnu des Liu des Wei du Nord. Son grand-père Liu Zheng et son père Liu Wei servirent comme préfets régionaux sous les Tang, appartenant à la classe moyenne des lettrés-fonctionnaires. Durant l’ère Tianbao (742–756), il fut témoin de la transition du Tang de l’apogée au déclin, mais choisit une voie divergente de ses contemporains.
Contrairement à la plupart des poètes du Haut Tang qui poursuivaient des carrières officielles, après avoir brièvement échoué aux examens impériaux dans sa jeunesse, il abandonna toute aspiration officielle et se retira sur les rives des rivières Ying et Ru (actuels Xuchang et Ruzhou dans le Henan). Les Biographies des poètes talentueux des Tang le décrivent comme « vivant en recluse dans le Grand Val de Yangyang, noble et sans charge », s’associant à des ermites comme Yuan Dexiu et Huangfu Ran. Ce choix ne fut pas un simple échappisme, mais une redéfinition des valeurs des lettrés-fonctionnaires après la rébellion d’An Lushan—comme l’exprime son poème À l’administrateur Yan VIII : « De loin, j’imagine Luoyang comme la Source aux Fleurs de Pêcher ; / Les affaires du monde, vastes et obscures, sont inconnaissables. »
Poète-peintre, il excellait dans les paysages, pins et rochers ; le Registre des peintres célèbres à travers les âges de Zhang Yanyuan classa ses œuvres « de grade supérieur pour technique exquise ». Cette identité artistique duale influença profondément sa poésie, formant un style unique de « peinture dans la poésie, zen dans la peinture ». Il mourut vers le début de l’ère Zhenyuan (env. 785) dans son ermitage. Son épitaphe reste introuvable, et les détails biographiques sont largement perdus, faisant écho à son vers : « Dix mille ombres naissent de la lune, / Mille voix deviennent automne »—une présence claire mais insaisissable comme la lumière lunaire.
Réalisations artistiques
Métaphysique
Liu reconfigura le paradigme d’expression spatio-temporelle de la poésie tang. Dans son chef-d’œuvre Nuit de lune, il transforme créativement l’espace-temps physique en espace-temps perceptif :
« Nuit plus profonde, la lumière de lune baigne la moitié des maisons, / La Grande Ourse s’incline, les Étoiles du Sud penchent. / Cette nuit je sens le toucher de la chaleur printanière, / Chants d’insectes percent newly la gaze verte de la fenêtre. »
Le poème construit une géométrie de lumière et d’ombre avec « la lumière de lune baigne la moitié des maisons » ; les mouvements astraux (Grande Ourse, Étoiles du Sud) métaphorisent l’écoulement du temps ; finalement, la percée auditive des « chants d’insectes » complète la boucle perceptive de l’immensité cosmique à la vie microscopique. Cette philosophie de « connaître le printemps par l’infime » précède le « voir un monde dans un grain de sable » de Blake par un millénaire.
Sa Navigation par une nuit d’automne pousse plus loin la sensation spatiale :
« Nuit sur les étangs boisés, la barque glisse, / Bourdonnements d’insectes, chuchotements de roseaux. / Dix mille ombres naissent de la lune, / Mille voix deviennent automne. »
Par la description quantifiée « dix mille ombres / mille voix », il déconstruit la nuit d’automne en un champ de vibrations lumineuses et sonores, révélant la perspicacité zen du poète sur l’essence matérielle.
Psychologie
Liu transcenda l’expression stéréotypée des lamentations traditionnelles de gynécée, pionnier du réalisme psychologique. Plainte printanière est acclamé comme « le modèle de description psychologique en poésie tang » :
« Coucher de soleil through les fenêtres de gaze, le crépuscule approche, / Dans la chambre dorée, personne ne voit les taches de larmes. / Cour déserte, solitude, le printemps tarde à finir, / Fleurs de poirier couvrent le sol, porte close. »
La chaîne d’images « fenêtre de gaze - crépuscule - chambre dorée - taches de larmes - cour déserte - fleurs de poirier », par double oppression d’enfermement spatial (porte close) et de décadence temporelle (printemps finissant), visualise la détresse psychologique féminine. Comparé à la plainte sociale de Wang Changling (« regretter d’avoir enseigné à mon mari à chercher la gloire titrée »), Liu se concentre davantage sur la dissection des émotions internes, influençant directement le style subtil de Wen Tingyun (« Collines en couches, or scintillant éteint »).
Plainte printanière (au nom de…) montre son talent narratif :
« Loriots persistants de l’aube pleurent avec la dame, / Tirant le rideau, seule herbe luxuriante vue. / Parfois le vent d’est entre dans la cour, / Rameaux de saule tous penchent vers l’ouest. »
L’image des « saules penchés vers l’ouest » suggère la direction du guerrier absent ; cette politique implicite de direction porte une tension émotionnelle plus grande que le lyrisme direct.
Esthétique visuelle
En poète-peintre, Liu intégra des techniques picturales dans la poésie. Dans Adieu, « Lune de montagne persiste à l’aube, / Brise forestière fraîche, incessante » évoque un rouleau de lavis d’encre, créant le vide par la technique de « laisser en blanc » ; Chant de cueillette du lotus « Coucher de soleil sur rivière claire, / Chants Jing, taille svelte de Chu » ressemble à une peinture vive de dame de cour, sa technique de coloration influençant directement le style luxuriant de Li He (« ceinture de nuage rose, jupe de soie de lotus »).
L’érudit japonais Iritani Sensuke note dans Visualité dans la poésie tang : les termes visuels à haute fréquence dans la poésie de Liu—« lune », « fenêtre », « gaze », « ombre »—constituent le noyau de sa « poétique de la transparence ». Cette quête fait écho à son identité de peintre. Bien que l’authenticité soit douteuse, une prétendue copie Song des Pins et Rochers de Liu Fangping au MFA de Boston atteste de son influence intermédiale.
Influence
Processus de canonisation
Sous les Tang, Liu fut un poète non mainstream, absent de l’Anthologie des esprits héroïques des rivières et montagnes. L’anthologie Song du Nord Poèmes tang d’enthousiasme inclut pour la première fois Nuit de lune ; le compilateur Ming Gao Bing dans Classification de la poésie tang le classa comme poète « transitionnel », louant sa « lucidité, subtilité, profondeur, ouvrant une voie distincte ». L’exclusion des 300 Poèmes tang des Qing fit de lui un « trésor secret » parmi les lettrés—les Notes aléatoires sur la poésie de Yuan Mei acclamèrent Plainte printanière : « Vingt-huit caractères comme des ombres de rideau de cristal, exquisément transparents. »
La véritable canonisation advint au XXe siècle. Les Essais sur la poésie tang de Wen Yiduo le nommèrent « lavant le vacarme du Haut Tang avec la lumière de lune » ; le sinologue canadien Stephen Owen consacra une section dans Le Grand Âge de la poésie chinoise à analyser sa « poétique microcosmique » ; le lauréat Nobel japonais Kenzaburō Ōe cita à plusieurs reprises « dix mille ombres naissent de la lune » dans L’Arbre vert flamboyant, y voyant l’essence de l’esthétique orientale.
Influence transculturelle
Liu compte parmi les rares poètes tang ayant influencé la poésie moderne occidentale. L’imagiste américaine Amy Lowell imita Nuit de lune dans Tablettes de fleur de sapin, transformant sa technique lumière-ombre en « La lumière de lune coupe la maison en deux » ; le compositeur français Olivier Messiaen s’inspira de Plainte printanière pour sa suite pour piano La Cour des fleurs de poirier.
En Asie orientale, ses poèmes entrèrent tôt dans les systèmes esthétiques. L’Anthologie de récitation japonaise-chinoise du Japon inclut « Cette nuit je sens le toucher de la chaleur printanière » ; l’Œuvre complète de Yodang de l’érudit coréen Joseon Jeong Yakyong utilisa « chants d’insectes percent la fenêtre » pour argumenter l’universalité d’« investiguer les choses et étendre la connaissance » ; dans le film hongkongais contemporain In the Mood for Love, la composition du plan où Maggie Cheung fixe la fenêtre fait écho à l’esthétique visuelle de Plainte printanière.
Recherche académique
Les recherches récentes montrent des percées multidimensionnelles : l’analyse numérique de l’Université Fudan révéla son usage fréquent d’adverbes comme « percer », « particulièrement », « newly », formant un unique « langage poétique de l’incertitude » ; des archéologues découvrirent des fragments de « gaze verte de fenêtre » sur un site de cour tang à Luoyang, confirmant la réalité matérielle de ses descriptions ; le Supplément aux Poèmes complets des Tang découvrit de nouveaux poèmes d’échange avec le moine Jiaoran, éclairant ses origines zen.
Ce poète de seulement 26 poèmes survivants est comme le son automnal qu’il décrivit : « mille voix deviennent automne »—bien que le volume soit infime, chacun constitue un univers complet. Dans le dialogue actuel entre globalisation et localité, la sagesse orientale de Liu Fangping de « voir l’éternel dans le minuscule » trouve une résonance sans précédent.