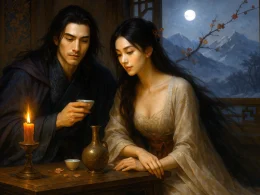Les crêtes méridionales s’enroulent en replis,
Ce lieu sacré s’y établit.
Le temple se reflète dans l’ombre des falaises nuageuses,
Les moines traversent les sources rocheuses.
Dragons et serpents luttent en mouvements subtils,
Esprits et démons veillent en secret.
Mille ravins se précipitent vers le lieu de culte,
Tous les pics se tournent vers les arbres jumeaux.
Les fleurs célestes voltigent sans se poser,
La lune sur l’eau trace un chemin blanc.
Aujourd’hui, contemplant mon propre corps,
Où donc mon cœur errant trouvera-t-il refuge ?
Poème chinois
「题栖霞寺」
綦毋潜
南山势回合,灵境依此住。
殿转云崖阴,僧探石泉度。
龙蛇争翕习,神鬼皆密护。
万壑奔道场,群峰向双树。
天花飞不著,水月白成路。
今日观身我,归心复何处。
Explication du poème
Ce poème fut composé en 756, la quinzième année de l'ère Tianbao sous l'empereur Xuanzong des Tang, alors que la révolte d'An Lushan et Shi Siming plongeait l'empire dans le chaos. Qiwu Qian, déjà âgé, voyageait vers le sud pour fuir les troubles et séjourna brièvement au temple Qixia sur la montagne du même nom près de Jinling (actuel Nanjing). Dans ce lieu empreint de sérénité et de mystère bouddhique, le poète, ému par les paysages grandioses et l'atmosphère religieuse, exprime aussi ses réflexions sur un monde en crise et son propre exil. Ce poème, prenant les paysages montagneux comme point de départ, fusionne imagerie bouddhique et méditation cosmique, révélant les sentiments complexes du poète entre retrait du monde et quête spirituelle - une ode monastique où scènes, émotions et philosophie s'entrelacent.
Premier distique : « 南山势回合,灵境依此住。 »
Nán shān shì huí hé, líng jìng yī cǐ zhù.
"La montagne du sud déploie ses contours sinueux,
Ce royaume spirituel s'établit en ces lieux."
Avec une perspective large, le poète dépeint la topographie majestueuse du mont Qixia. "Contours sinueux" évoque à la fois les formes montagneuses et les courants énergétiques cosmiques. "Royaume spirituel" désigne ce sanctuaire bouddhique, posé d'emblée comme un espace transcendant, établissant une atmosphère solennelle et mystique.
Second distique : « 殿转云崖阴,僧探石泉度。 »
Diàn zhuǎn yún yá yīn, sēng tàn shí quán dù
"Les halls s'enroulent à l'ombre des falaises nuageuses,
Les moines traversent, sondant sources et roches."
Ce distique capture l'intimité du temple entre mouvement et immobilité. Les bâtiments épousent la montagne, disparaissant dans les brumes, tandis que les moines en exploration incarnent la symbiose entre vie monastique et nature. Les verbes "sonder" et "traverser" insufflent une dynamique à cette scène paisible.
Troisième distique : « 龙蛇争翕习,神鬼皆密护。 »
Lóng shé zhēng xī xí, shén guǐ jiē mì hù.
"Dragons et serpents s'entrelacent en flux vital,
Dieux et esprits veillent en protecteurs discrets."
Énergies cosmiques ("dragons et serpents") et entités surnaturelles ("dieux et esprits") convergent pour sanctifier ce lieu. "S'entrelacer" suggère l'harmonie des forces yin-yang, tandis que "protecteurs discrets" renforce l'aura sacrée du site, inviolable et béni.
Quatrième distique : « 万壑奔道场,群峰向双树。 »
Wàn hè bēn dào chǎng, qún fēng xiàng shuāng shù.
"Mille ravins convergent vers ce lieu d'éveil,
Les pics s'inclinent devant les arbres jumeaux."
Hyperbole poétique où la nature entière semble vénérer le sanctuaire ("lieu d'éveil"). "Arbres jumeaux" font référence aux salas sous lesquels Bouddha entra dans le nirvana, symbolisant ici l'illumination vers laquelle tout converge.
Cinquième distique : « 天花飞不著,水月白成路。 »
Tiān huā fēi bù zhuó, shuǐ yuè bái chéng lù.
"Fleurs célestes voltigeant sans se poser,
Lune sur l'eau trace une voie blanche."
Images quintessencielles du bouddhisme Chan. Les "fleurs célestes" (offrandes divines) restent suspendues, illustrant le concept de vacuité (śūnyatā), tandis que le reflet lunaire, bien qu'illusion (māyā), guide paradoxalement le chemin spirituel ("voie blanche").
Sixième distique : « 今日观身我,归心复何处。 »
Jīn rì guān shēn wǒ, guī xīn fù hé chù.
"Aujourd'hui contemplant mon être,
Où donc ma cœur errant trouvera refuge ?"
Conclusion introspective. "Contemplant mon être" renvoie à la méditation bouddhique sur la nature du soi, tandis que la question finale révèle la quête existentielle du poète dans un monde en crise - désir de retrait mais incertitude du lieu.
Lecture globale
Ce poème superpose trois niveaux : paysager (montagne/temple), religieux (symboles bouddhiques) et existentiel (quête personnelle). La structure progresse du macrocosme ("montagne du sud") au microcosme ("mon être"), passant par des images médiatrices (moines, dragons, fleurs célestes). Le temple Qixia devient à la fois un lieu physique et une métaphore de la quête spirituelle en temps troublés.
Spécificités stylistiques
- Symbolisme bouddhique intégré : Termes comme "lieu d'éveil", "arbres jumeaux", "fleurs célestes" enrichissent le texte sans pédantisme.
- Dialectique présence/absence : Fleurs qui ne se posent pas, reflet lunaire réel mais illusoire - jeu sur les paradoxes bouddhiques.
- Mouvement centripète : Tous les éléments (ravins, pics) convergent vers le sanctuaire, comme vers un centre spirituel.
- Équilibre sacré/profane : Paysages concrets (sources, roches) et entités surnaturelles (dragons, esprits) coexistent harmonieusement.
Éclairages
Dans ce poème, Qixia n'est pas qu'un refuge physique mais un espace transitionnel où le poète négocie son rapport au monde chaotique. La question finale - "où trouver refuge ?" - transcende son contexte historique pour interroger la condition humaine : comment concrétiser nos aspirations spirituelles dans un monde imparfait ? La "voie blanche" sur l'eau suggère que les réponses peuvent émerger des illusions mêmes, dans cet entre-deux où réalité et perception dansent. Une leçon précieuse pour notre époque tout aussi troublée.
À propos du poète

Qiwu Qian (綦毋潜 692 - env. 755), originaire de Ganzhou (actuelle Ganzhou, Jiangxi), fut un poète éminent de l'École paysagère et pastorale durant la haute époque Tang. Il obtint le titre de jinshi en 726 (14ᵉ année de l'ère Kaiyuan) et occupa des postes officiels tels que Rectificateur des Omissions (You Shiyi) et Directeur des Archives impériales (Zhuzuo Lang) avant de se retirer dans la région du Jiangnan. Sa poésie, célèbre pour ses descriptions de la vie recluse et des paysages naturels, se caractérise par un style serein et dépouillé. Il échangea des poèmes avec des figures littéraires comme Wang Wei et Meng Haoran. Les Poèmes complets des Tang (Quan Tangshi) conservent 26 de ses poèmes, qui se distinguent dans la tradition paysagère du haut Tang et exercèrent une influence significative sur le développement ultérieur de la poésie inspirée du zen.